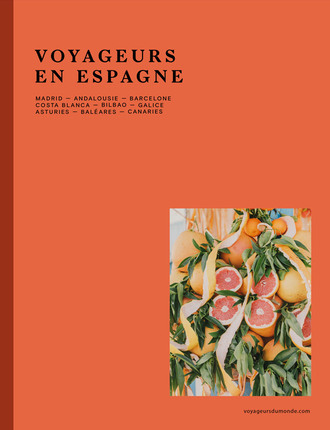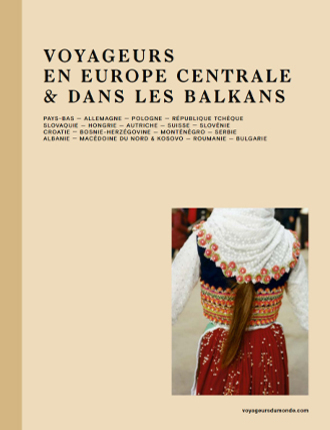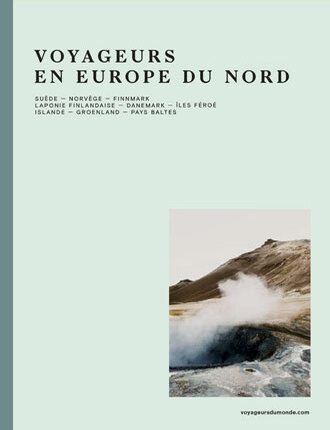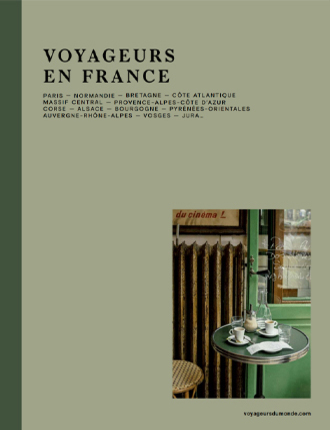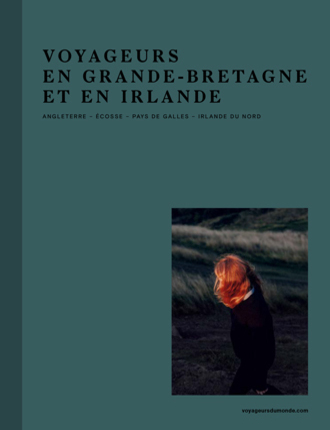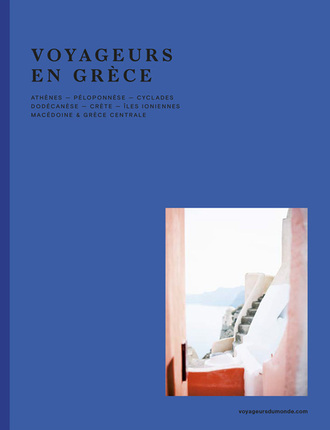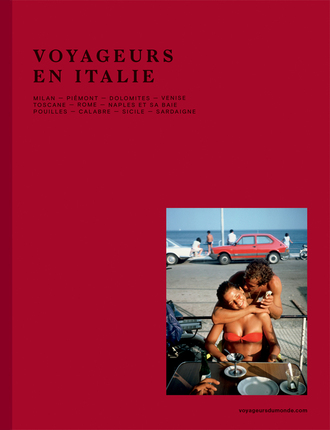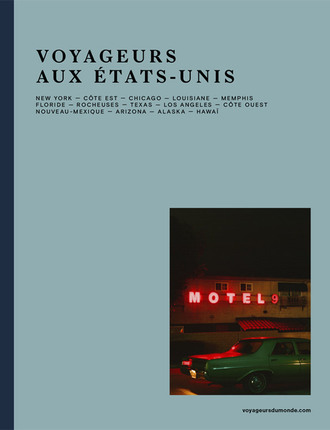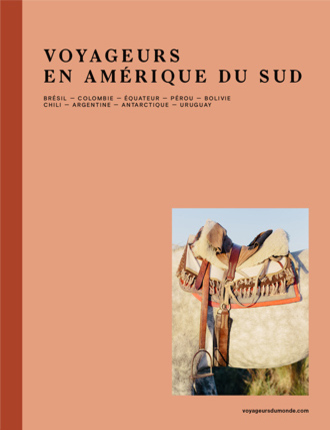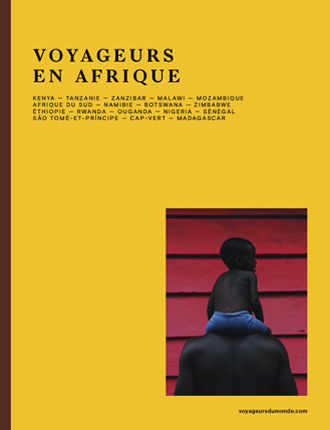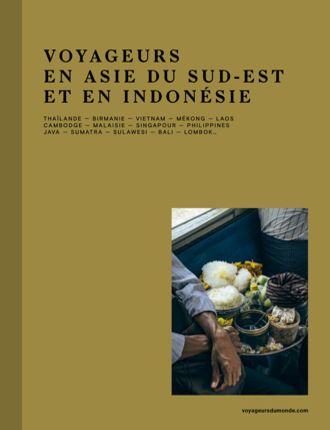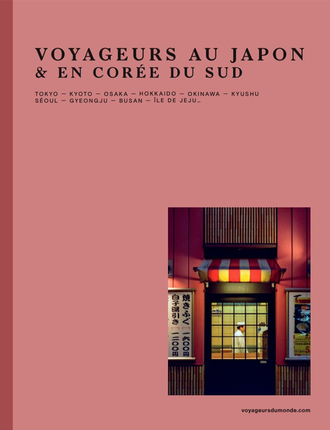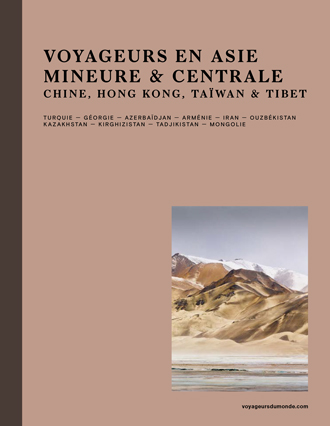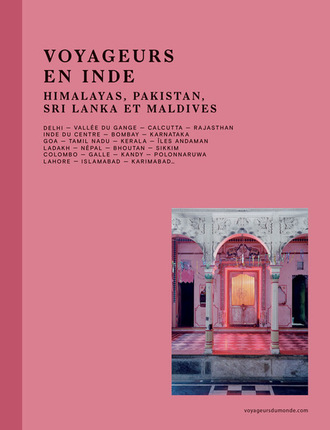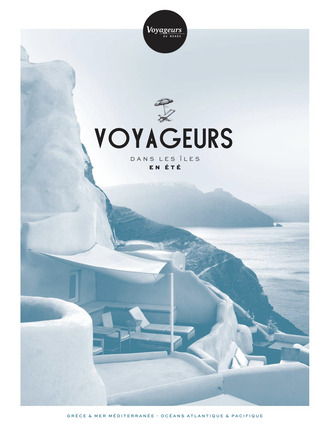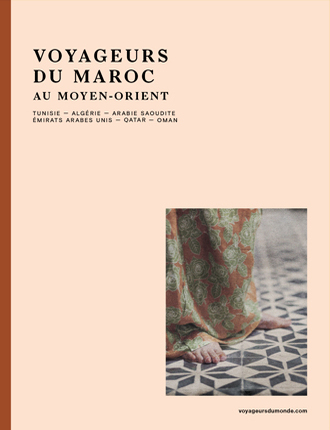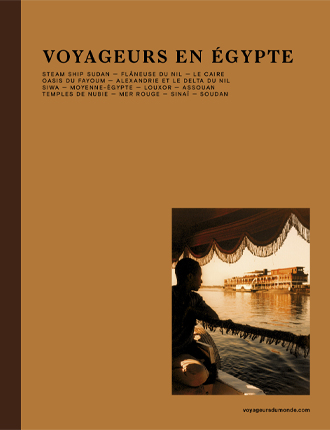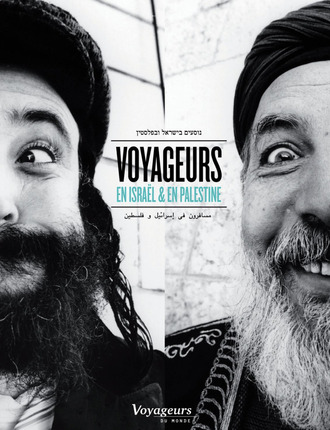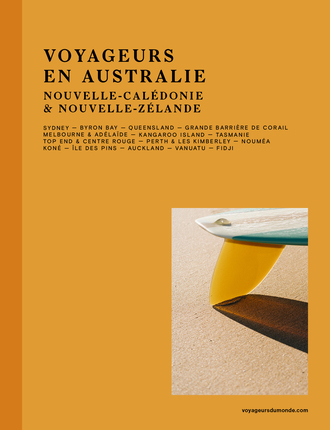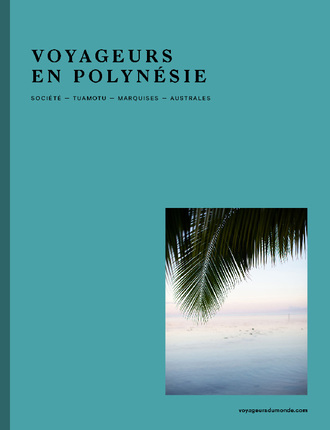Population
5 920 007, en 2025.
Langue officielle
Le danois, de facto.
Langues parlées
Plus de 85% des habitants du Danemark proprement dit ont le danois pour langue maternelle. Ensuite, viennent les 1,6% d’arabophones, les locuteurs de l’ourdou et du polonais, respectivement 1,3% et 0,7%. Dans ce cadre, 0,3% des habitants parlent le féroïen et 0,1% le groenlandais. Le danois, le norvégien et le suédois sont mutuellement intelligibles. Le danois standard est fondé sur le parler de Zélande, mais les variétés dialectales sont nombreuses. Les Danois parlent aussi l’anglais, trop sans doute, assez en tout cas pour alerter sur la pérennité pratique de la langue nationale.
Peuples
Les Danois sont un vieux peuple germanique, mentionné par plusieurs historiens du Haut Moyen Âge. Ils furent l’un des composants du monde viking. Puis un peuple scandinave, européen. Le pays n’a officialisé qu’une minorité : les 38 000 sujets de culture allemande du Jutland méridional. De nos jours, les ressortissants d’origine étrangère seraient autour de 14%. La question migratoire alimente les débats, qui ont déterminé une nouvelle attitude restrictive.
Religions
La Folkekirken, l’Église du peuple, est l’église nationale danoise. De confession luthérienne. 80% des Danois en sont membres (sans se montrer forcément très impliqués ni assidus). Par comparaison, les catholiques se situent autour de 1,3%. Les musulmans de 0,8%. Sinon dans le Jutland méridional, l’Église est en charge de l’état civil. Les juifs furent invités à s’installer au Danemark au XVIIe siècle. Pendant la 2nde Guerre mondiale, ils sont mis à l’abri en Suède (et les déportés de Terezin activement suivis par les autorités danoises). Aujourd’hui, cette communauté compte environ 7000 personnes. Le néopaganisme nordique rassemble quelques centaines d’adeptes.
Fête nationale
5 juin : jour de la Constitution de 1849.
Calendrier des fêtes
1er janvier : nouvel an.
Mars ou avril : Pâques.
4e vendredi après Pâques : store bededag, jour des prières.
40 jours après Pâques : Ascension.
7e dimanche après Pâques : Pentecôte.
5 juin : fête nationale.
24, 25 et 26 décembre : fêtes de Noël.
Politique
Le Royaume de Danemark est une monarchie constitutionnelle qui réunit dans l’Unité du Royaume le Danemark proprement dit, l’archipel des Féroé et le Groenland. Le système garantit aux derniers une large autonomie (seules la politique monétaire, la défense et les relations internationales sont réservées). Le roi est le chef de l’État. Il assume une fonction symbolique et de représentation. S’il est de facto investi du pouvoir exécutif, en pratique il nomme le premier ministre (expression d’une coalition parlementaire), vrai responsable opérationnel. Celui-ci compose le gouvernement. Dépositaire du pouvoir législatif, le Parlement, Folketing, est unicaméral, à 179 députés élus pour un mandat de quatre ans. Le Groenland et les Féroé, qui ont leur propre parlement, envoient chacun deux députés à Copenhague. Le pouvoir judiciaire a sa plus haute expression dans la Cour suprême, Hojesteret. Le Danemark est membre de l’Union européenne (ce n’est le cas ni du Groenland, ni des Féroé), du Conseil nordique et du Conseil de l’Arctique.
Histoire
La culture néolithique Yamna n’est certes pas la première à occuper l’actuel territoire danois, mais les Danois d’aujourd’hui ont encore quelques liens génétiques avec elle. On commence donc au 5e millénaire. Puis ce sont l’Âge du bronze et celui du fer. Ce qui nous conduit autour de notre ère. Les pays danois entretiennent des relations suivies avec l’empire romain. Après la chute de celui-ci, les turbulences s’accentuent dans le monde germanique. Les Daner de Scanie s’installent au Jutland. Ils y laisseront leur nom. La situation se stabilise. Des figures de roi apparaissent ; en partie légendaires, elles indiquent au moins l’inscription de la région dans un système.
Au VIIIe siècle s’ouvre la période Viking. Ces Normands (de nordmann) ont été des navigateurs intrépides et des commerçants avisés. Il furent aussi la terreur du monde carolingien et de la Grande-Bretagne. C’est avec des Danois que Rolf le Marcheur jette au Xe siècle les bases du futur duché de Normandie. Au cours de cette période, le pays entre prudemment dans le nouveau monde d’alors par la porte chrétienne, que lui tiennent les missionnaires germaniques. Le roi Harald à la Dent bleue est baptisé en 965 ; son sceptre en est affermi. C’est dans une inscription runique d’Harald (grosse pierre de Jelling) que l’on trouve pour la première fois le terme Danemark. Au diapason de la chrétienté, le Danemark donc adopte la féodalité : l’Église gère et administre ; les nobles se battent et intriguent ; les bourgeois cherchent leur place ; les paysans turbinent. Au XIIe siècle, avec Valdemar le Grand, la monarchie devient héréditaire. Elle étend son influence, politique et religieuse, sur les rives de la Baltique. Puissance régionale dont il faut tenir compte. La peste noire n’en a cure et frappe durement le Danemark au XIVe siècle. C’est Marguerite 1ère qui rétablit les choses. Ayant empilé sur son chef les couronnes de Danemark, de Norvège et de Suède, elle impose son successeur et l’union perpétuelle des trois royaumes par l’Union de Kalmar de 1397. Il s’agit ainsi et aussi de damer le pion à la Ligue hanséatique.
Néanmoins, l’Union n’est pas un jardin de roses. Le Danemark tire la couverture à lui. La Suède résiste. La Norvège est ballottée. Le XVe siècle voit le pacte rompu deux fois. En 1523, sous Gustave 1er Vasa, la Suède prend définitivement le large. Le temps a rattrapé la perpétuité. Danemark et Norvège poursuivent en tandem. Les conflits avec l’ex-partenaire rythment la vie du pays. Au XVIe siècle, sous Christian III, le luthéranisme supplante le catholicisme. C’est Frédéric II qui remanie en style Renaissance la forteresse de Kronborg, près d’Elseneur, où Shakespeare situe l’action de Hamlet. Le Danmark-Norge tire parti de sa situation géographique pour s’enrichir. Et en profite pour se moderniser. Une frange prospère de la société vit à l’européenne. On prend sa part de la fortune changeante des remuements continentaux. Le Groenland, les Féroé, l’Islande – mais aussi les Orcades et les Shetland – étaient venus par la Norvège. En revanche, Tranquebar est fondé au Tamil Nadu par l’Ostindisk Kompagni danoise en 1620. Il y eut un empire colonial : comptoirs de l’Inde orientale ; en Afrique, la Côte de l’Or, dans l’actuel Ghana ; aux Antilles, les îles Vierges. La flotte et une activité commerciale tous azimuts (dont la traite négrière) assurent au Danemark un standing certain aux XVIIe et au XVIIIe siècles. Le mercantilisme bat son plein.
Le XIXe est mitigé. Il débute sous des auspices napoléoniens. De plus ou moins bon gré. Ce qui vaut au pays un blocus anglais. Rude coup pour l’économie. Puis les aigles flanchent. Faillite du Danemark, auquel la Suède et l’Angleterre imposent le traité de Kiel, 14 janvier 1814. La Norvège passe à la Suède ; le Danemark conserve les Féroé, le Groenland et l’Islande, la Prusse lui faisant cadeau du duché de Lauenbourg. Il faut se réorganiser. Les idées nationales gagnent du terrain ici comme ailleurs. Le libéralisme cherche des issues. En 1849, la monarchie adopte une constitution parlementaire : diète à deux chambres, Landsting (chambre des grands) et Folketing (chambre du peuple). Le pays vit un peu à la remorque de son temps. L’unification allemande vient frapper à sa porte et lui réclame les trois duchés du Schleswig, Holstein et Lauenbourg. La Prusse intervient au Schleswig. Au bout du compte, protocole de Londres 1852, la succession des duchés reste au roi du Danemark, mais leur statut d’autonomie est entériné. En 1863, nouveau problème de succession et nouvelles tensions nationalistes. Avec des objectifs différents, la Prusse et l’Autriche interviennent dans les duchés allemands. Les opérations sont à leur avantage et le 30 octobre 1864, par le traité de Vienne, le Danemark perd les duchés. Avec la vente de l’empire aux Britanniques et aux Américains, c’est un siècle de contraction. L’émigration danoise aux États-Unis est importante. Comble de dépression, les Danois hésitent devant le génie d’Andersen.
À peu près réduit à son périmètre nucléaire, le Danemark se réorganise encore une fois. Le Folketing accède à la pleine légitimité législative. Libéraux et Radicaux prennent les affaires en main. Après quelques décennies de libération progressive, le droit de vote est accordé aux femmes en 1915. L’État providence s’esquisse. Pour rester à la marge de la 1ère Guerre mondiale, le pays n’en souffre pas moins dans son économie. La fin du conflit lui rend par plébiscite le nord du Schleswig. Les années 20 amènent les Sociaux-Démocrates aux manettes. Long bail. Les réformes sociales sont poursuivies. Hitler respecte la neutralité danoise his way : le pays est envahi par l’armée allemande en avril 1940, opération Weserübung. L’occupation a plusieurs phases qui voient se renforcer la mainmise nazie. Le sauvetage des juifs danois est unique. Pendant ce temps, Britanniques et Américains ont installé des troupes aux Féroé, au Groenland et en Islande. Cette dernière rompt unilatéralement, à l’expiration de l’Acte d’Union dano-islandais en 1943, ses liens avec le Danemark. Lequel entérine à la fin de la guerre.
Après-guerre, le pays adhère à l’ONU et à l’OTAN, au Conseil nordique. L’autonomie des Féroé et du Groenland dans le cadre du royaume trouve sa formule. Le Landsting est aboli. En 1973, le Danemark rejoint la Communauté européenne (et participe depuis à géométrie variable aux différentes versions de l’organisation). Dans les années 60 et 70, la liberté danoise est donnée en exemple par les progressistes occidentaux. Le pont de l’Oresund, qui relie depuis l’an 2000 Copenhague à Malmö, en Suède, est un symbole positif de l’intégration politique continentale. Les attentats terroristes des années 2010 en sont un de l’exposition des démocraties à la violence. Le Danemark, à cet égard, fait preuve de sang-froid et de résilience. L’art du compromis politique cimente une société qui ne se laisse pas entamer ainsi. Le pays est régulier sur le podium mondial des pays où il fait bon vivre.
Personnalités
Margrethe II, née en 1940. Issue de la maison de Schleswig Holstein Sonderburg Glücksburg, qui fournit des souverains au royaume depuis 1863, elle est la mère du roi actuel, Frederik X. Elle est aussi championne du Danemark de règne personnel : 1972-2024. Lorsqu’elle a abdiqué, les Danois ont perdu un symbole familier. Ses talents artistiques l’ont amenée à illustrer une édition de The Lord of the Rings de Tolkien.
Asta Nielsen, 1881-1972. Le cinéma contemporain fournit son lot de Danois, que chacun sait. En revanche, il n’est sans doute pas inutile de rappeler que l’une des toutes premières étoiles internationales du cinématographe fut Asta Nielsen, née à Copenhague. Le naturalisme de son jeu a épaté les réalisateurs et les cinéphiles. Dans La Rue sans joie de Pabst, Greta Garbo, qui partage l’affiche avec elle, apprend le métier. Hitler la voulait pour propagandiste, elle préféra aider les déportés de Theresienstadt.
Carl Theodor Dreyer, 1889-1962. L’impossible, voilà ce qui meut le cinéma de Dreyer, personnages et réalisateur. Le formidable travail formel qui rend ses quatorze films si singuliers tient vraisemblablement aux moyens à mettre en œuvre pour cerner le trop espéré de ses héroïnes. À cette fin, il fallait se montrer précis. Dreyer fut méticuleux. Dans les années 60, la jeune garde des réalisateurs et des critiques a volontiers reconnu la dette qu’elle avait envers lui.
Sören Kierkegaard, 1813-1855. Il fut un Danois très peu danois, si l’on s’en tient au lieu commun qui fait de ses compatriotes des gens positifs et joviaux. Théologien, philosophe, écrivain, il est certainement – par ses réflexions sur l’existence singulière, la mémoire, le désespoir et l’angoisse – une racine de la modernité européenne. Et une illustration de l’importance culturelle de la traduction : écrivant en danois, il fut d’abord réservé aux lecteurs nordiques. Puis vinrent des gens comme Paul-Henri Tisseau, en France.
Inge Lehmann, 1888-1993. Elle a étudié les mathématiques, la chimie, la physique et l’astronomie à l’université de Copenhague. Il y a des gens comme ça. Après avoir été actuaire, elle devient géodésiste, directrice du département de sismologie du Geodaetisk Institut et montre que le centre liquide de la terre contient un noyau solide. On n’entreprend pas d’expliquer ce qu’est la discontinuité de Lehmann, les personnes intéressées se reporteront aux ouvrages spécialisés.
Niels Bohr, 1885-1962. On sait l’apport de Bohr à la mécanique quantique et son prix Nobel de physique de 1922. Ce qu’on sait moins, c’est qu’il fut un footballeur de valeur. On laisse aux spécialistes le soin d’apprécier l’apport scientifique et on relève la compatibilité du sport et des neurones. Par ailleurs, Niels Bohr eut des enfants, dont Aage, qui fut à son tour lauréat du prix Nobel de physique – en 1975 – pour des travaux sur la structure du noyau atomique. Il était né l’année du Nobel paternel.
Mikkel Hansen, né en 1987. En voilà un Viking ! Un qui fait trembler les adversaires et les filets. Le genre à ne pas s’émouvoir de croiser Nikola Karabatic. Un guerrier. Un handballeur qui fut plusieurs fois le meilleur du monde. Il est de rigueur que le champion rende hommage à l’équipe, sans laquelle il ne saurait briller. Il est tout aussi rigoureux de constater qu’une équipe qui a un tel arrière gauche dans ses rangs possède un atout que les autres n’ont pas.
Borge Rosenbaum, Victor Borge, 1909-2000. Ils ne sont pas nombreux ceux qui font rire avec un piano, de façon délibérée s’entend. Victor Borge y parvenait avec brio et élégance. Enfant prodige, il fut un concertiste précoce. Il pimentait déjà ses concerts sérieux d’avant-guerre de blagues antinazies. Émigré aux États-Unis, il se convertit franchement à l’entertainment et à l’humour. Technique brillante et large pratique du répertoire lui fournissant une abondante matière à plaisanteries.
René Redzepi, né en 1977. C’est le chef de Noma, meilleur restaurant du monde pour le britannique Restaurant et trois étoiles au Guide rouge. L’un des protagonistes majeurs de la nouvelle cuisine nordique : technique d’avant-garde, open mind et ingrédients impeccables. Avec cela, beaucoup de limpidité dans l’articulation des saveurs. Bref, l’incarnation gastronomique d’un aspect de l’esprit contemporain auquel les Danois adhèrent volontiers. Et pas qu’eux !
Kristine Marie Jensen, 1858-1923. Froken Jensen, comme on l’appelle au Danemark, a écrit et publié en 1901 l’indispensable Froken Jensens Kogebog. Le livre de cuisine traditionnelle danoise. Pas le premier – il y avait déjà eu ceux d’Anne Marie Mangor et de Louise Nimb – mais celui qui est arrivé au bon moment : alors que la société évoluait et que les conditions de vie s’amélioraient, que le monde d’autrefois s’estompait, l’ouvrage assumait l’héritage et en adaptait la pratique.
Savoir-vivre
Le pourboire est à l’appréciation des clients. Pour toute personne intervenant dans le cadre des prestations achetées par notre intermédiaire, il ne se substitue jamais à un salaire. Néanmoins, il est d’usage un peu partout dans le monde de verser un pourboire lorsqu’on a été satisfait du service.
En ce qui concerne le personnel local – serveurs, porteurs, etc. – les usages varient. Le mieux est d’aligner votre pourboire sur le prix d’une bière, par exemple, ou d’un thé, d’un paquet de cigarettes. Il vous donne un aperçu du niveau de vie et vous permet, comme vous le faites naturellement chez vous, d’estimer un montant.
Les choses ont bien changé depuis que les Vikings ravageaient les monastères. Aujourd’hui (et depuis le XIXe siècle, le terme trouvant alors sont acception moderne), le hygge définit l’art de vivre danois. Il s’agit d’une forme de bien-être liée à l’intimité et à un sentiment confortant de sécurité. Sur cette base, le hygge est accueillant et positif. Ainsi définit-il une attitude pratique envers la vie. Il n’est en rien passif. Une esthétique homy et confortable lui correspond, à laquelle les intérieurs danois se conforment volontiers ; sous cet aspect déco, il s’exporte.
Cuisine
Si les Danois ont des spécialités auxquelles ils tiennent, on a le sentiment, à se pencher sur l’histoire de leur alimentation, qu’ils n’ont pas développé – comme en France, par exemple – d’aversion particulière pour le tournant industriel de l’alimentation. Lequel a correspondu à une nette amélioration de l’ordinaire. Le terroir n’a pas été un champ de manœuvre idéologique. La situation s’expliquerait mieux par la technologie, le commerce, l’évolution du composé social que par la passion politique. La nouvelle cuisine danoise doit d’ailleurs son naturel à une grande sophistication technique. Et à une attitude open minded.
Deux fois froid et une fois chaud, c’est la formule ordinaire des repas de la journée. Le chaud étant pris le soir.
La viande et le poisson ont la faveur des Danois – sans doute est-ce d’avoir trop longtemps mangé du chou, des pois cassés ou du gruau. Les salades ont pourtant fait une percée au XXe siècle, soutenue désormais pas les considérations green et healthy. La betterave et le chou rouge sont récurrents. Pour autant, le cochon résiste vaillamment. Et stegt flaesk peut à bon droit passer pour le plat national. Il s’agit de poitrine de porc frite, servie avec des pommes de terre bouillies et une sauce au persil. Les saucisses sont une passion danoise. Les frikadeller sont des boulettes mi-veau mi-porc, parmi bien d’autres boulettes. La soupe de pois gule aerter s’enrichit de viande de porc ou de saucisse medisterpolse. Le bœuf trouve aussi le chemin des cuisines. Hjerter i flodesovs, le cœur de veau farci à la crème, peut illustrer la cuisine des abats. La volaille n’est pas en reste. Avec la poule au pot, on prépare hons i asparges, qui ajoute à la viande un hachis d’asperges, de la crème et des jaunes d’œuf ; servi avec les ubiquitaires pommes de terres bouillies et persil. Pour préparer solaeg, on passe des œufs durs en saumure avec un oignon rouge ; le résultat, qui a un aspect marbré, est servi avec de la moutarde. Noël met le bœuf et l’âne dans la crèche ; il met aussi l’oie au four. La dilection danoise pour le poisson n’étonne pas. Le hareng (sild) tenant un peu dans ce domaine la place du porc dans le sien. Les recettes sont très nombreuses et Clupea harengus est consommé toute l’année, sous une forme ou sous une autre. La plie est un challenger crédible (à Skagen, on la fait griller et on la sert avec une sauce airelles / groseilles). La morue en est un autre ; son importance culturelle étant au moins égale à celle du hareng. Fort ancienne est la recette de l’anguille roulée (et farcie à l’oignon). Le saumon occupe une place correspondant à son statut dans l’alimentation mondiale. Parmi les fruits de mer, on note des huîtres à la saveur animée d’iode et de noisette et de délicieuses crevettes. Puisqu’il faut chercher des solutions alimentaires nouvelles, le Danemark s’intéresse vivement aux qualités nutritives et gustatives des algues. Les producteurs danois sont un peu le diable dans la fromagerie : ils viseraient à remplacer les bonnes coagulations traditionnelles par de vulgaires copies industrielles. De la mauvaise foi en meule. Cependant, c’est faire peu de cas de leur réel savoir-faire et d’une approche différente de la question. En outre, il y a des fromages danois ; comme le rygeost de Fionie, fromage frais fumé très convaincant. Les yaourts et la crème sont l’honneur des vaches laitières. Un peu de sucre ? Le wienerbrod a des formes, des garnitures, des glaçages divers, mais toujours une texture de type croissant. Et on le trouve à peu près partout. Rodgrod est un gruau sucré de fruits rouges, servi en dessert, souvent avec de la crème fouettée.
Avec le fameux smorrebrod, on est à la limite du paragraphe suivant. Néanmoins, le statut des tartines de pain de seigle ne répond pas seulement à la notion de cuisine sur le pouce. C’est une institution. Et la matière de bien des déjeuners. Tranche de pain de seigle donc, beurrée dans sa plus simple expression, mais désormais garnie de toutes les manières possibles. Un aspect engageant et une saveur cohérente étant les seules bornes posées à l’imagination. Anguille et œufs brouillés, leverpostej et bacon, hareng mariné, saumon fumé, boulettes sont des classiques parmi d’autres.
Street food : que seraient les villes danoises sans leurs stands à hot-dogs (polsevogn) ? Pas ce qu’elles sont. Un bun, une longue saucisse rouge, oignon, cornichon, sauce rémoulade sont la base. Il y a des aménagements, mais la formule est assez intangible. En tout cas, pas de circuit danois sans un arrêt au stand. Le flaeskestegssandwich a lui aussi ses comptoirs. Il s’agit d’un pain à burger garni de porc à la peau croustillante, de chou rouge et de divers condiments. Lorsque le porc est pile poil, c’est fameux.
Boissons
Les grands brasseurs danois vendent leurs pils à travers le monde. À l’ombre des industriels, brasseries artisanales et microbrasseries produisent des bières moins standard. Le vin a fait son chemin dans les habitudes de consommation. La plus ancienne mention de l’aquavit est danoise. Aujourd’hui, la réglementation en fait un alcool éthylique redistillé avec des graines de carvi ou d’aneth (et diversement épicé). Avec la bière, il accompagne les repas traditionnels. À Noël mais pas que, on boit le glogg : eau de vie aux épices, additionnée de vin rouge, chauffée et servie avec amandes effilées et raisins secs trempés au rhum. Du hygge dans un verre. Eggnog, le lait de poule, est associé lui aussi à la fin de l’année. Au quotidien, les Danois sont grands consommateurs de sodas. Faxe Kondi est l’un des plus réguliers. De nombreuses eaux minérales permettent d’éviter ça.