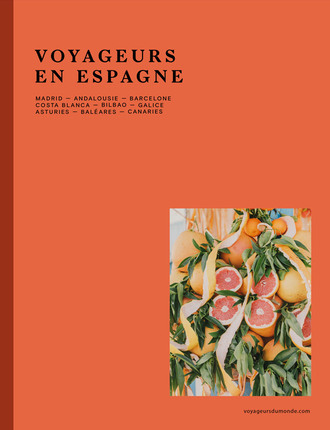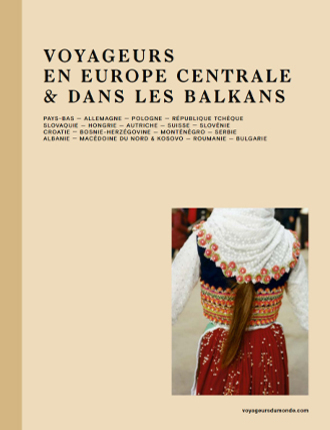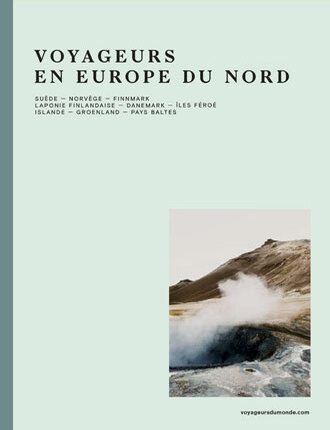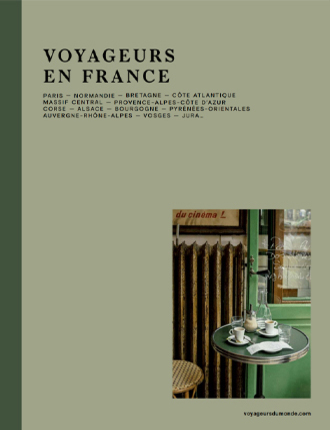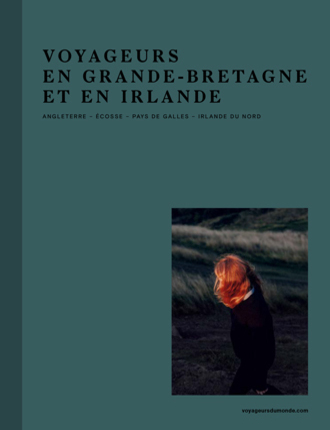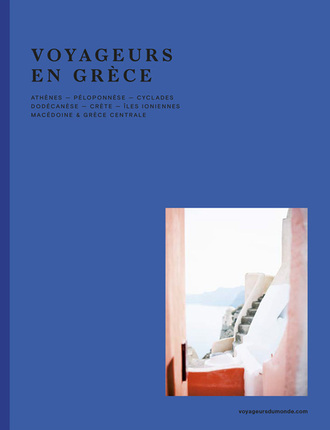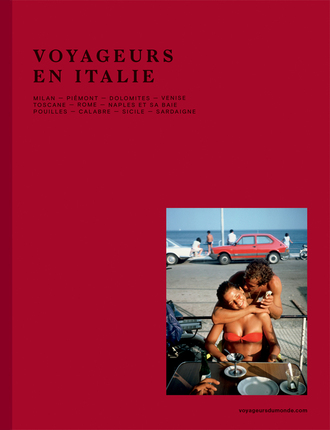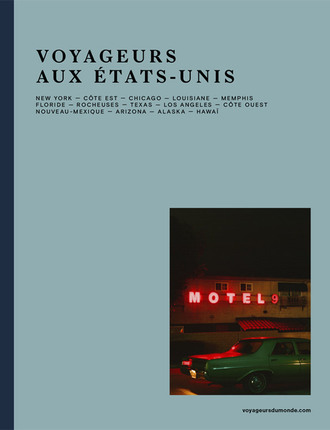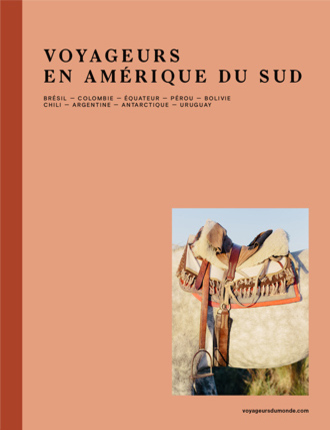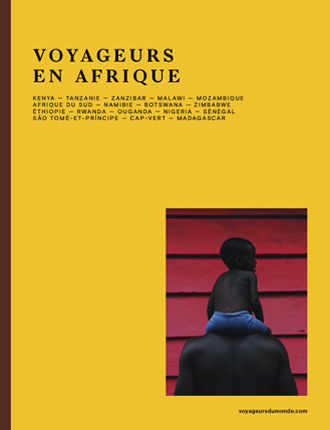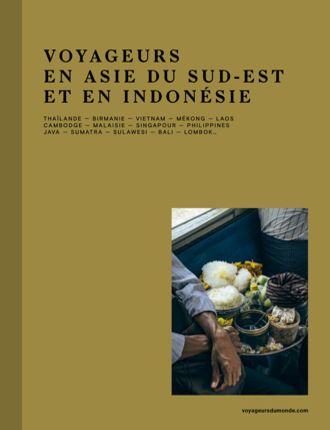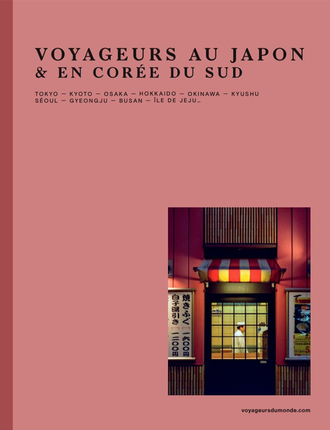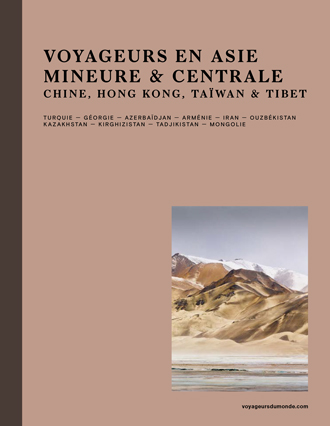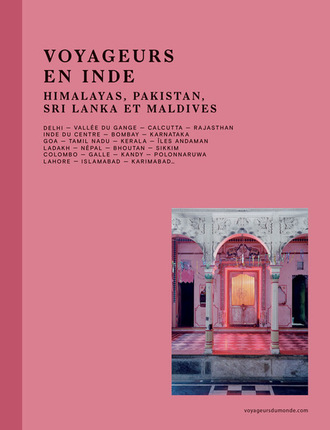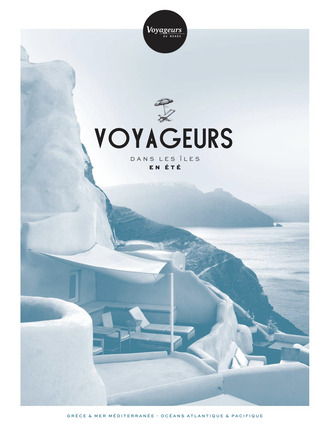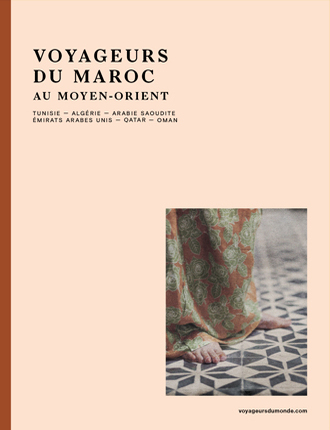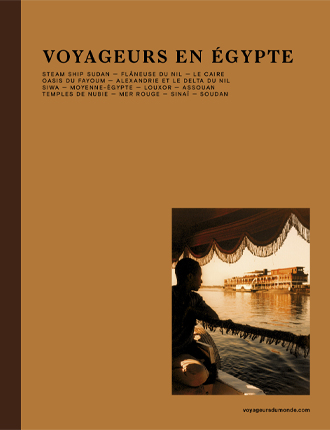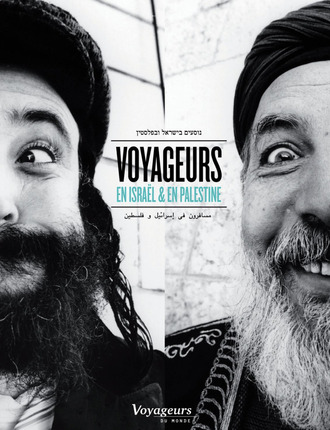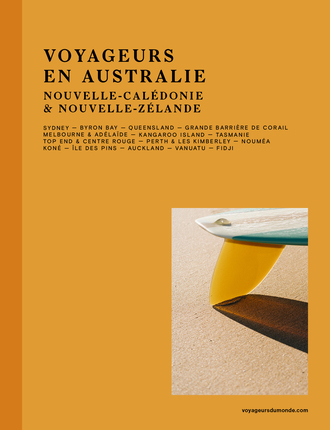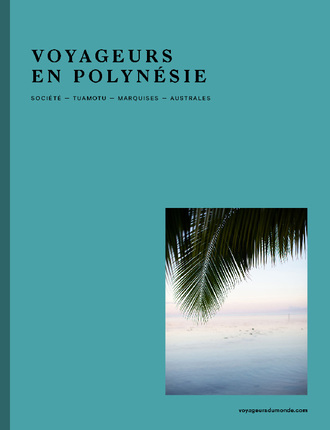Capitale
Guatemala City.
Climat
Dans l’ensemble, climat tropical. La différence entre saison sèche (de novembre à mai) et saison des pluies (de juin à octobre) est moins marquée qu’au Mexique voisin. Jusqu’à s’estomper dans le centre-nord (entrée des alizées par la baie du Honduras), que l’on peut qualifier d’équatorial. Partout, des pluies surviennent en saison sèche. Dans le Petén, notamment. Les températures contrastent en fonction de l’altitude. Il fait très chaud et humide dans les basses terres ; sur l’Altiplano, le mercure est plus clément ; dans les montagnes, il peut faire frais, au moins le soir et la nuit.
À Guatemala City, les températures moyennes sont en décembre de 18,6°C ; en mars, de 20,4°C ; en juillet, de 20,8°C ; en septembre, de 20,8°C. À Flores, elles sont respectivement de 24°C ; 26,1°C ; 27,8°C ; 27,8°C. À Quetzaltenango, de 13°C ; 14,2°C ; 14,8°C ; 14,9°C. À San José, de 26,2°C ; 27,6°C ; 27,8°C ; 27,4°C. À Puerto Barios, de 24,1°C ; 25,6°C ; 27,2°C ; 27,4°C.
Géographie
SUPERFICIE : 108 890 km².
POINT CULMINANT : le volcan Tajumulco, dans la Sierra Madre de Chiapas, 4 220 mètres.
PAYS LIMITROPHES : Mexique, Belize, Honduras, El Salvador.
Pays de l’isthme panaméricain, le Guatemala a une belle façade pacifique et une porte dérobée sur la mer des Caraïbes, dans la baie du Honduras. Ces secteurs littoraux sont essentiellement plains. Pour l’intérieur, le pays est constitué d’un ensemble de hauts plateaux montagneux, marqués par un puissant volcanisme : l’Altiplano. Deux systèmes principaux, dirigés nord-ouest / sud-est, occupent le sud-ouest : la Sierra Madre de Chiapas dessous et la Sierra de los Cuchumatanes dessus (elle cumine à La Torre, 3 828 mètres). C’est la tectonique des plaques qui a généreusement pourvu le pays de volcans – trente-sept au total, dont trois sont actifs : Pacaya, Santiaguito et Fuego. Au nord, le vaste plateau calcaire du Petén s’abaisse vers le Yucatán et s’y prolonge. Entre la Sierra Madre et celle de los Cuchumatanes, la vallée du fleuve Motagua. Le Golfo Dulce, dans le département d’Izabal, est le plus grand lac du Guatemala. Il reçoit les eaux du rio Polochic et verse les siennes dans la baie du Honduras via le Golfete Dulce et le rio Dulce. Atitlán et Petén Itza sont eux aussi des lacs remarquables, dans un pays qui en compte beaucoup. L’hydrographie est dense. Le rio Sarstun marque une partie de la frontière avec le Belize. Et l’Usumacinta celle qui sépare le Guatemala de l’État mexicain du Chiapas.
Faune et flore
Le Guatemala est classé mégadivers par l’Unesco : il abrite un nombre exceptionnellement élevé d’espèces animales et végétales. De ce règne-ci : jungles et savanes du Petén ; formations apparentées au bord de la baie du Honduras et de l’océan Pacifique ; mangroves (dont le palétuvier rouge constitue l’ossature) ; forêt de montagne de l’Altiplano (chênes corrugata, skinneri, oleoides, etc., et pins chiapensis, tecunumanii, ayacahuite, etc.) ; bosque nuboso du centre ; maquis épineux du Huehuetenango. La flore guatémaltèque est fastueuse. On note l’acajou, le kapokier, Calophyllum antillanum pour leur fréquence, mais ce ne sont que trois entrées dans un inventaire considérable. Plus de deux cents espèces d’arbres sont répertoriées dans la seule sylve maya du Petén. Palmiers, plantes épiphytes, broméliacées, mousses accompagnent.
Cucurbita moschata, Guatemalan Blue, güisquil (chayote), le pays a un long compagnonnage avec les courges. Autant avec les haricots et le maïs. L’association des trois plantes est préhispanique. L’utilisation du cacao et du piment aussi. L’avocat de variété quilaoacatl a été domestiqué sur les hauts plateaux du Guatemala. Aujourd’hui, la production de canne à sucre ou de cardamome – originaires d’Asie du Sud-Est – est importante. Tout comme celle de café ou de melon – originaires d’Afrique.
Dans ces environnements souvent clos, touffus, profus, on entend et on entrevoit. Le matin, il faut avoir l’oreille exercée pour distinguer parmi les autres le solitaire ardoisé, le merle enfumé, le toucan à carène, le cacique de Montezuma, le dindon ocellé, l’amazone poudrée, l’Attila à croupion jaune ou la pénélope pajuil. Le hurleur du Guatemala n’est pas un oiseau, mais un singe : Alouatta pigra. L’ortalide chacamel, le grand tinamou ou la chouette mouchetée ont le chant vespéral. Sa grande taille, ses couleurs vives et contrastées rendent l’ara rouge aisément identifiable. L’aigle orné est un bel oiseau beige, blanc et noir ; assez proche au point de vue chromatique de la femelle du grand hocco. L’étrange oréophase cornu est menacé. Les oiseaux-mouches pompent le nectar des fleurs, citons seulement le colibri féérique, le colibri d’Elliot et celui de Sybil. De nombreux félins – jaguar, ocelot, jaguarondi, margay – marquent par leur présence la bonne tenue de la faune sylvestre. Le puma préfère les milieux plus ouverts. Le singe-araignée aux mains noires est un acrobate précis. Des mammifères en vrac : tapir de Baird ; agouti ponctué ; cerf de Virginie ; tatou à neuf bandes ; coati à nez blanc ; pécari à collier ; opossum laineux ; daguet d’Amérique centrale. Pour les marins, cela va du grand cachalot au globicéphale tropical. Le lamantin des Caraïbes est le plus grand des siréniens. Quant aux reptiles – qui sont légion – on se contentera du crocodile de Morelet, qui a un refuge dans le Golfo Dulce. Et de l’iguane vert, tiens. Les insectes ne sont pas en reste. Voyons quelques libellules. Verte, Anax amazili se confond avec son environnement lacustre. Beige et noir, Erythrodiplax umbrata est assez élégante. Micrathyria hagenii a de splendides yeux bleus. La barrière de corail mésoaméricaine et son apparat multicolore passent dans la mer des Caraïbes au large du Guatemala.
Le quetzal resplendissant et l’orchidée épiphyte Lycaste virginalis, vivant l’un et l’autre dans la bosque nuboso, sont des emblèmes du Guatemala.
Situation environnementale
Pollution de l’air et des eaux, gestion déficiente des déchets, déforestation, dégradation des sols : il n’y a pas de miracle environnemental guatémaltèque. Pour autant, la situation n’est pas des plus catastrophiques. Le pays pointe loin des premières places en termes d’émission de gaz à effet de serre : en 2023, 1,13 tonne CO2 / habitant ; France, 4,25 tonnes. Au total, autour de 0,08% des émissions mondiales, objectif de réduction de 11% à l’horizon 2030. Les autorités manifestent une réelle prise de conscience de l’importance des questions environnementales. Le cadre légal manque encore de consistance, mais la bonne volonté est évidente et les informations sont fiables. Les mesures de conservation engagées ont des résultats contrastés. Donc bons, dans certains cas. La forêt, par exemple. Du fait surtout des productions d’huile de palme et de biocarburant, elle est en contraction. Elle a perdu 10% de sa superficie entre 2000 et 2020, pour se situer autour de 30% du territoire national. Néanmoins, le recul semble enrayé. Acteurs internationaux et communautés locales parviennent à travailler de concert. Les énergies renouvelables imposent leur pertinence (reste à la mettre en œuvre). Néanmoins, gaz d’échappement ou bois brûlé, l’air doit être assaini partout. Les rejets domestiques et industriels (miniers notamment) sont cause d’une pollution préoccupante des eaux. Une gestion efficace des déchets est encore à établir. Autour de ces carences, les problèmes écologiques ont des conséquences sociales et de santé publique graves. Activité tellurique, dérèglement climatique, le pays est fortement exposé à ces risques.
Le Guatemala compte vingt-deux parcs nationaux. Parmi ceux-ci, Tikal vient d’abord à l’esprit. Ce parc du Petén, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, abrite une cité majeure du monde maya et l’un des grands sites archéologiques mésoaméricains. Les ruines de Tikal jouissent d’une renommée méritée. Elles ne doivent pas éclipser cependant le contexte de sylve tropicale dans lequel elles s’inscrivent. Parmi les arbres-cadors, des kapokiers géants, l’acajou amer et le mahogany grandes feuilles. La faune est à l’avenant : agouti ponctué, coati à nez blanc, renard des arbres, singe-araignée de Geoffroy doivent se garder du jaguar et du puma. Trois oiseaux pour exemples : la harpie féroce, le dindon ocellé, la pénélope panachée. Au Petén encore, la Laguna del Tigre fait partie de la Réserve de biosphère maya. C’est le plus grand parc national du Guatemala. Et un site Ramsar – zone humide d’importance internationale – abritant de vastes savanes. L’élevage bovin pénètre illégalement ce sanctuaire. Dans le centre du pays, le parc national de la Laguna Lachua entoure de jungle un cenote aux relents sulfureux. Site Ramsar ; alors, tantale d’Amérique, dendrocygne à ventre noir, grèbe à bec cerclé, courlan brun, sarcelle soucrourou, etc. On rencontre aussi le daguet rouge, le pécari à lèvres blanches et le tapir de Baird. Le hurleur du Guatemala y fait entendre son cri sonore. Les autorités du parc doivent lutter ferme contre les empiètements de l’exploitation forestière. À l’est – dans le département d’Izabal, entre le Golfo Dulce et la mer – se trouve le parc national du Rio Dulce. Les secteurs de mangrove et les herbiers marins où se nourrit le lamantin ont l’attention spéciale des conservateurs. Le Volcan de Pacaya est un parc et une bouche à feu de l’arc volcanique de l’Amérique centrale, dont l’activité plus ou moins soutenue inquiète et fascine. Il se trouve dans le Guatemala méridional. Dans l’ensemble, les domaines protégés subissent des pressions, mais l’activité qui s’y déploie en faveur du patrimoine environnemental national mérite d’être soulignée.
Économie et tourisme
IDH en 2022 : 0,781 / France, 0,910.
PIB par habitant en 2023 : 13 790,02 dollars US / France, 44 460,80.
L’agriculture compte dans l’économie du Guatemala : 10% du PIB ; la moitié des exportations de biens ; la moitié de la population active. Ceci pour les cash crops (café, canne à sucre, cardamome, banane, cacao, etc.) et sans évaluer l’informel secteur vivrier. Dans ce contexte, l’agroalimentaire est le secteur industriel n°1. Le boom des biocarburants a provoqué l’extension des cultures de canne à sucre et de palmier à huile, au détriment du maïs. Une activité manufacturière s’est développée en direction des États-Unis : les maquiladoras assemblent à bas prix pour ce premier partenaire commercial. Le potentiel minier est réel : or, argent, nickel, terres rares. Le Guatemala est un petit producteur de pétrole. Les énergies renouvelables ont une vraie part dans le mix électrique : 67,2% de la production (énergies fossiles, surtout gaz, autour de 25%), dans lesquels l’hydroélectricité entre pour 40%, la biomasse pour 25% et la géothermie pour 2%. Produits pharmaceutiques et textiles, cartonnages s’exportent. Les services connaissent une croissance rapide. L’importance par ailleurs des transferts d’argent des Guatémaltèques de l’étranger – près de 25% du PIB – décèle de profonds déséquilibres sociaux. Les remesas font vivre près d’un tiers des habitants du pays (et en soutiennent la résilience économique). La moitié de la population subsistant tant bien que mal sous le seuil de pauvreté. Structure du PIB : agriculture, 10% ; industrie, 22% ; services, 68%.
Dans le domaine des services, le tourisme est un atout majeur. Le pays est accessible et, si des sites fameux – Tikal, lac Atitlán, Antigua Guatemala, etc. – ont attiré les voyageurs depuis longtemps, son potentiel de développement, dans le tourisme vert notamment (réserve de biosphère maya et autres parcs nationaux), est important. Le littoral pacifique, mais aussi caraïbe, entretient une activité balnéaire de bon niveau. Les volcans suscitent de façon croissante curiosité et randonnée.